Publié en août 2011
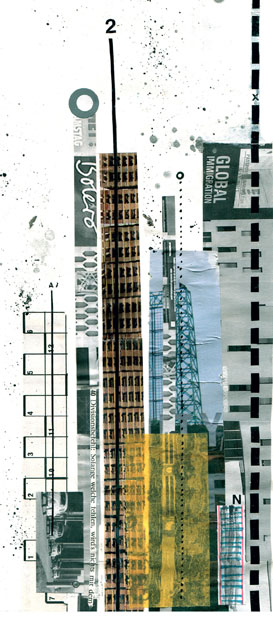 BEL FALLEIROSLa société Quacquarelli Symonds (QS), qui évalue et classe annuellement depuis 2004 des universités du monde entier, a publié en juillet 2011 le premier classement mondial séparé par domaines de connaissance (disponible sur le site Internet www.topuniversities.com). Certains cursus brésiliens sont relativement bien placés entre les 200 premiers, en particulier dans les groupes généraux de « sciences sociales » et « arts et humanités ». Les listes spécifient les positions de 1 à 50 puis réunissent en trois groupes, par ordre alphabétique, les institutions qui se situent entre les positions 51-100, 100-150 et 151-200. Six institutions brésiliennes apparaissent dans le calcul général des sciences humaines : deux universités d’état (Université de São Paulo et Unicamp), deux universités fédérales (Université Fédérale de Rio de Janeiro et Université Fédérale de Minas Gerais), la Fondation Getúlio Vargas (FVG) et l’Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro (PUC-Rio). À noter également la présence de deux universités d’autres pays latino-américains (Université Nationale Autonome du Mexique et Université Catholique Pontificale du Chili).
BEL FALLEIROSLa société Quacquarelli Symonds (QS), qui évalue et classe annuellement depuis 2004 des universités du monde entier, a publié en juillet 2011 le premier classement mondial séparé par domaines de connaissance (disponible sur le site Internet www.topuniversities.com). Certains cursus brésiliens sont relativement bien placés entre les 200 premiers, en particulier dans les groupes généraux de « sciences sociales » et « arts et humanités ». Les listes spécifient les positions de 1 à 50 puis réunissent en trois groupes, par ordre alphabétique, les institutions qui se situent entre les positions 51-100, 100-150 et 151-200. Six institutions brésiliennes apparaissent dans le calcul général des sciences humaines : deux universités d’état (Université de São Paulo et Unicamp), deux universités fédérales (Université Fédérale de Rio de Janeiro et Université Fédérale de Minas Gerais), la Fondation Getúlio Vargas (FVG) et l’Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro (PUC-Rio). À noter également la présence de deux universités d’autres pays latino-américains (Université Nationale Autonome du Mexique et Université Catholique Pontificale du Chili).
De l’Université de São Paulo (USP), la philosophie et la sociologie se sont classées dans le groupe 51-100, et la géographie et les relations internationales dans le groupe 151-200. L’Université de Campinas (Unicamp) se situe entre 101-150 en philosophie et entre 151-200 en statistiques et recherche opérationnelle. Avec ces deux mêmes cursus, l’Université Fédérale de Rio de Janeiro occupe les positions inverses. La Fondation Gétulio Vargas apparaît entre 151-200 pour les relations internationales et l’Université Fédérale de Minas Gerais est dans le même groupe pour la philosophie. À titre de comparaison, seules trois universités sont représentées dans les domaines des sciences exactes et biomédicales : USP (agronomie entre 51 et 100 et ingénierie civile entre 151 et 200) ; Unicamp (ingénierie électrique et électronique, entre 151 et 200) ; et PUC-Rio (ingénierie civile, entre 151 et 200).
D’après Modesto Florenzano, vice directeur de la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines (FFLCH) de l’USP – qui abrite trois départements cités dans le classement (philosophie, sociologie et géographie) –, « les critères qui orientent ces classements ne peuvent être considérés comme uniques ou même infaillibles, cependant il serait absurde de méconnaître leur utilité et la visibilité qu’ils apportent ». Spécialiste en scientométrie, l’étude des aspects quantitatifs de la science et de la production scientifique, Rogério Meneghini explique que « la plus grande finalité de ces listes – et c’est là-dessus qu’elles sont économiquement basées –, c’est d’offrir aux personnes qui ont l’intention d’entrer dans les institutions un panorama des universités. Par conséquent, faire une recherche par discipline est une bonne initiative. […] Les classements n’ont pas été faits pour donner une vision large de la qualité des universités, mais elles ont fini par servir à cela ».
Située au Royaume-Uni avec des bureaux dans plusieurs pays, la QS élabore intentionnellement ses classements pour aider les étudiants qui veulent étudier en dehors de leur ville ou, surtout, de leur pays d’origine. C’est pour cette raison qu’elle met particulièrement l’accent sur le degré d’internationalisation des institutions évaluées. Le dernier classement a été fait sur la base de trois grands critères : réputation universitaire (des professeurs ont été invités à évaluer des cours et des universités qui ne sont pas les leurs), réputation par les employeurs (sur la qualité des professionnels sortis des institutions) et nombre de citations dans des publications universitaires.
La société QS considère que l’inclusion de l’item « employabilité » est le grand différentiel de ses classements, même si les critiques estiment qu’il s’agit d’un indice qui n’a pas nécessairement de rapport avec la qualité de la production intellectuelle des universités. Ben Stower, chef de l’unité d’information de la QS, explique : « Pour notre public cible, il serait disproportionné d’intensifier encore plus l’accent déjà donné à la recherche universitaire. En outre, les autres classements le font déjà, en partie par le type de données disponibles internationalement et en partie par rapport à l’histoire de leur apparition. Le premier classement international a été créé par le gouvernement chinois [via l’Université de Shanghai] pour distinguer les prouesses de la recherche scientifique dans leurs universités en comparaison avec celles de l’Occident ».
Toutefois, le classement de la QS n’est pas non plus exempt de données biaisées. Un premier coup d’œil sur les listes suffit pour constater la présence massive et prédominante d’universités de pays de langue anglaise (pas seulement les États-Unis et le Royaume-Uni, mais aussi le Canada et l’Australie). Dans le classement de philosophie, par exemple, les institutions des pays qui ont le plus contribué historiquement (et jusqu’à aujourd’hui) à ce champ du savoir, la France et l’Allemagne, sont peu et faiblement représentées. D’où l’interrogation de Ricardo Ribeiro Terra, professeur du Département de Philosophie de la FFLCH-USP et coordinateur du domaine des sciences humaines et sociales de la FAPESP (philosophie) : « Comment l’université de Frankfurt, qui compte Jürgen Habermas et Axel Honneth, peut-elle se trouver en bas de la liste ? ».
Ricardo R. Terra observe également une quantité faible ou nulle d’articles dans des publications internationales de certains cursus brésiliens, y compris bien évalués comme celui de sociologie : « Cela soulève des doutes quant à l’ensemble de revues choisies et amène à supposer qu’on se limite à la philosophie analytique du type hégémonique des États-Unis ».
Financement – D’un autre côté, la langue anglaise comme paramètre international reste une donnée incontournable. D’après Rogério Meneghini, « l’intérêt d’étudiants étrangers pour venir étudier au Brésil est perceptible, en grande partie pour la possibilité de réussir un financement pour la recherche à un stade initial de la carrière universitaire. Même la bourse paraît attractive, mais la majorité ne vient pas parce que le portugais est vu comme une barrière ».
Dans ce sens, le poids attribué par la QS à l’internationalisation dans ses évaluations est vu comme correcte – et parallèlement, tous sont d’accord pour dire qu’il y a encore peu d’étudiants étrangers dans les universités brésiliennes. Pour Stower, « les principales universités ont toujours été des points de rencontre des meilleurs esprits du monde. Une grande partie de la mise en avant de l’internationalisation n’est pas seulement effectuée par les institutions individuellement, mais aussi par des politiques gouvernementales. Dernièrement, les universités sont devenues centrales pour la politique économique, parce que les gouvernements se sont aperçus que recherche et innovation jouent des rôles-clés dans la stimulation de la croissance ».
Mais peser la qualité des cours à partir de critères numériques d’internationalisation n’est pas chose facile. Ricardo R. Terra observe que « dans le domaine des sciences sociales, la plupart des travaux se réfèrent à des questions brésiliennes, et ils ne sont naturellement pas diffusés dans des publications étrangères. Il faudrait penser à des critères qui évaluent également l’impact interne ». En même temps, les caractéristiques régionales peuvent être à l’origine du prestige de certaines recherches brésiliennes. « La haute complexité territoriale et sociale du Brésil a exigé la création d’une théorie sophistiquée », affirme Antonio Carlos Robert de Moraes du Département de Géographie de la FFLCH-USP et coordonnateur du domaine des sciences humaines et sociales de la FAPESP (géographie).
Les observateurs des classements internationaux sont unanimes pour affirmer que vu leur création récente, les critères doivent encore subir plusieurs améliorations. Même la société QS est d’accord sur ce point, et la décision de créer un classement par domaine a eu pour objectif de rendre plus spécifiques et utiles les classements.
Paula Montero, professeur du département d’anthropologie de la FFLCH-USP et coordinatrice adjointe de la direction scientifique de la FAPESP, pense que « la question la plus délicate concerne la possibilité de produire des critères compatibles avec les différentes façons de produire de la connaissance dans les diverses disciplines ». Elle considère le critère de consultation des pairs (réputation universitaire) comme le plus important : « Quand un domaine de connaissance est suffisamment développé et diversifié, ce type d’évaluation externe fonctionne très bien ».
Même s’il est le mieux établi, le critère de citations dans des publications universitaires est également la cible de restrictions. « Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai pas vu de mesures qui tente d’évaluer la qualité de la recherche », dit Meneghini. D’autre part, les données sur cette question sont recueillies en nombres bruts, ce qui fait que des universités immenses comme l’USP sont avantagées dans la compétition.
Modestie – Malgré tout, le bon classement des cours de la FFLCH-USP ne surprend pas. Robert de Moraes observe : « Sans fausse modestie, le Département de Géographie de l’USP forme le reste du pays et donne le ton de la discipline en Amérique latine ». « Notre présence à l’étranger est très expressive et nous organisons une grande quantité de rencontres internationales », poursuit Ricardo R. Terra. Cela est en partie dû à l’origine de la FFLCH, qui fut le noyau central de la création de l’USP dans les années 1930 avec la venue de professeurs étrangers et en particulier français. « Nous avons déjà commencé internationalisés et nous sommes venus d’une forte tradition humaniste », indique Modesto Florenzano.
Du point de vue de Paula Montero, « les sciences sociales au Brésil ont toujours eu un niveau relativement bon pour des raisons historiques. Néanmoins, le déclin de la qualité de l’école publique, la massification de l’enseignement supérieur, le manque d’évaluation de la performance des universités et l’isolement relatif des sciences humaines par rapport au débat international sont des facteurs qui ont joué contre l’expansion et la consolidation de cette qualité ».
La tradition se reflète même dans un cursus récemment créé et qui ne fait pas partie de la FFLCH, celui de l’Institut des Relations Internationales (IRI). Maria Hermínia Brandão Tavares Almeida, directrice de l’institut, explique : « Je vais être très sincère. Je crois que dans ce classement nous avons été entraînés dans le sillage du Département de Sciences Politiques, bien plus ancien et connu que l’IRI, qui a été créé en 2004 et ne dispose d’un troisième cycle que depuis deux ans ». Ce nonobstant, la qualité du cours se reflète d’une certaine manière dans le classement.
Finalement, la présence sur des listes comme celles de la QS est à la fois importante et relative. Marcelo Ridenti, diplômé en sociologie de l’USP, professeur de l’Unicamp et coordinateur du domaine des sciences humaines et sociales de la FAPESP (sociologie), dit que « seules des universités peu consistantes se laissent diriger par des demandes de ce type de recherche, mais elles peuvent être un élément à prendre en compte dans les directives universitaires ». Menegheni, qui a participé aux commissions d’évaluation de l’université avec la présence de spécialistes étrangers, estime que « la procédure d’évaluation doit partir de la propre université, à l’exemple des collectes de données que fait périodiquement l’USP ». Florenzano est d’accord : « Nous devons surtout diagnostiquer la qualité des premier et deuxième cycles, c’est le point de départ le plus important ».
Republier